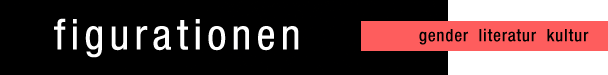Jeux d’ombres
On parle volontiers de jeu d’ombres dans la photographie, dans la peinture, parfois dans le cinéma. C’est en vérité que l’ombre n’est rien d’autre qu’un jeu de la lumière. L’ombre n’est pas une réalité autonome et consistante à la manière dont peut l’être l’obscurité (ou les ténèbres).
Car l’obscurité tient à l’absence de la lumière, elle ignore la lumière ou bien elle la refuse, la refoule ou bien l’éteint. En soufflant la bougie, en éteignant la lampe ou le projecteur, en fermant les volets en plein jour ou en abaissant les paupières sur nos yeux (si du moins la lumière autour de nous n’est pas trop vive), nous suscitons l’obscurité, la nuit où la vision se perd – ou bien se transforme en un autre sens, en un écarquillement aveugle qui tâtonne sans repères dans une épaisseur poisseuse et me-naçante.
L’ombre, au contraire, suppose la lumière. Elle suppose le jeu de la lumière qui se pose sur les choses et qui d’une part n’en éclaire entièrement que certaines faces, teintant les autres de ce qu’on nomme l’ « ombre propre », d’autre part projette au-delà des choses leurs silhouettes, pour peu qu’une surface se prête à en recevoir les contours de ce qu’on nomme dans ce cas l’« ombre portée ».
De l’une et de l’autre manière, l’ombre répond au jeu de la lumière lorsqu’elle ne se contente pas de rayonner et d’illuminer, d’être source lumineuse (lux) mais atteint les objets qui la reçoivent et font jouer à même leurs surfaces les reflets, les éclats ou les lueurs, les luisances ou les irisations, les brillances ou les pâleurs de la lumière devenue lumen, luminosité des choses mêmes. L’ombre appartient à cette luminosité comme le corps appartient à l’âme : il s’agit du jeu par lequel une réalité se distingue de soi afin de s’exposer pour ce qu’elle est au beau milieu du monde.
Or lux ne subsiste pas sans engendrer lumen, voire sans se transformer en lumen. Lux, de soi, n’est rien – rien que le sujet de l’éclat – ou bien le sujet du verbe « se propager avec la vitesse de la lumière ». Lux est une vitesse, à laquelle se bornent toutes les vitesses de l’univers. Lux explose, rayonne, éblouit, s’éblouit elle-même. Elle crève les yeux, si par malheur on doit la recevoir en pleine cornée. Elle ne subsiste que sur ce mode cruel, irradiant, anéantissant. Lux perce les ténèbres pour aussitôt plonger dans leurs épaisseurs déchirantes.
Lumen se modèle dans l’alternance des clartés et des ombres qui se tiennent les unes aux autres et dont aucune ne va seule. L’ombre peut être profonde ou discrète, elle peut se nommer « pénombre » ou bien confiner à la nuit – comme il arrive lorsque descend l’ombre du crépuscule : jamais elle n’est égale à l’obscurité, où elle disparaît tout autant que la lumière.
Elle est le jeu de la lumière en tant que celle-ci, cessant de purement rayonner, s’écarte de soi, se divise et se disperse, se fait indécise et fuyante. C’est un jeu interminable, où jamais ne cessent les diminutions ni les augmentations d’intensité, les gradations dans le partage et dans le passage, ou bien les déplacements des silhouettes, que ce soient celles du théâtre d’ombres ou bien celles des aiguilles des cadrans solaires. L’ombre est mobile : elle n’est que dans la mobilité. C’est pourquoi on appelle aussi « ombre » une silhouette indistincte qui se glisse dans les arrière-plans d’un paysage, et c’est pourquoi les cultures anciennes nommaient souvent « ombres » les morts représentés comme égarés sur les confins du monde plutôt que purement retranchés de lui.
La mort moderne réside dans les ténèbres, la mort ancienne et non monothéiste résidait dans les parages gris d’une frange ombreuse du monde des vivants.
Ainsi lux est l’affaire de Dieu, l’ouverture même de sa création, qui ne connaît pas d’ombres, de même qu’elle est aussi l’affaire du soleil de Platon qui brille loin au-dessus et au dehors de la caverne où se joue le spectacle dérisoire des apparences ombreuses.
Lux est l’affaire de la pensée de l’absolu et de l’inconditionné. Lumen se joue dans la sensation, dans le sentiment, dans les travaux et les jours. Tout s’y partage d’ombre et de clarté, rien n’y privilégie l’absolu.
L’absolu est le séparé de tout, l’isolé, l’écarté : l’éclat pur de l’étoile au bout du doigt de Dieu. Le relatif, qu’on lui oppose, n’est pas comme on le représente le pauvre débris qu’un « tout est relatif » jette dans l’insignifiance : le relatif existe dans la relation, il joue du rapport et c’est dans le rapport qu’il est absolument. L’ombre joue la relation de la lumière – matérialité de la vitesse pure – avec la surface – matérialité de l’immobile, ou du moins de la lenteur. Dès que lux heurte la surface et vire en lumen, l’ombre lui appartient sur toute l’étendue de son éclairage : le centre lumineux ne peut subsister comme tel s’il ne laisse se propager autour de lui la diminution de son intensité, la perte sans laquelle il se perdrait lui-même dans son pur éclat privé de contours.
L’ombre dessine la lumière, qui n’a pas de forme propre.
C’est pourquoi la lumière seule – l’éclat de la révélation, la lumière naturelle de la raison, le soleil de Platon, l’Aufklärung, l’enlightenment, l’illuminismo, la clarté de la preuve et la force de l’évidence – ne peut pas suffire à réaliser ce que doit être le cœur d’un savoir : l’expérience d’une forme, le contact d’une surface, de sa résistance et de sa densité, qu’il s’agisse du marbre, du sable ou de la mer, de la peur ou de l’amour.
Comment le jeu de l’ombre pourrait-il manquer à l’épreuve du discerne-ment : lorsqu’il s’agit de distinguer une chose de l’autre, une face et les faces cachées, la nécessité de leur dissimulation et la logique de la pénombre où elles nous entraînent avec elles?
L’ombre provient en fait de l’ombre : elle provient de ce qui, déjà, a porté la lumière hors de soi, ou bien de ce qui, en elle, était porté à s’obscurcir. Il en va de même du mot « ombre », en grec skia – terme dont l’étymologie est si étrangement confuse que les philologues se demandent si un tabou n’aurait pas empêché de garder en lumière la provenance du mot. Cette provenance resterait dans l’ombre, et donc en elle aussi celle de skotos : obscurité, aveuglement (dont on a fait le mot « scotomisation », employé en français pour la Verleugnung de Freud : dénier, obscurcir, jeter dans l’ombre). Le mot skéné est peut-être lui aussi apparenté ; car la « scène » fut d’abord un abri léger sur le pont d’un bateau, puis l’abri dressé au-dessus d’une scène de jeu : abri contre le soleil, protection contre une excessive lumière dans laquelle plus rien ne se présenterait. Skiagraphia désigne le dessin, la silhouette, par distinction d’avec zoographia qui désigne la peinture ; celle-ci, avec la couleur, fait donc représentation du vivant, tandis que le contour de l’ombre présente le disparu, le mort, l’absent (on se rappelle l’histoire de Dibutade). (Schatten, shadow sont de la famille skotos.)
Le théâtre n’est pas seulement à l’occasion théâtre d’ombres – ombres dites chinoises, silhouettes balinaises, cambodgiennes, autrichiennes, françaises, qui toutes ne sont que des ombres portées – car il se joue plus essentiellement dans l’ombre propre des corps éclairés de façon déterminée, directive, partielle, et qui ne se trouvent pas mis en lumière mais arrangés pour glisser sous les lumières, pour être poursuivis, conduits puis abandonnés par elles lorsqu’ils glissent dans les coulisses d’où peut-être ils surgiront à nouveau. L’ombre est ici le mystère de l’épaisseur des corps, de leur profondeur : c’est aussi ce que le cinéma capture, cette fois dans l’unique dimension d’un plan-écran peuplé d’ombres mobiles.
Ces ombres mêlent à leur pâleur – fût-elle coloriée – et à leur minceur (l’ombre ne peut avoir plus de deux dimensions : cela lui est essentiel) l’imminence d’une obscurité d’où elles émergent pour y plonger à nou-veau : c’est une vérité toujours émergeante et immergée, ombragée. Gior-dano Bruno l’avait bien compris, qui écrivait dans Les Ombres des Idées que nous devons examiner les premières faute de pouvoir fixer les secondes : mais ainsi nous pouvons acquérir la vérité qui nous incombe.
L’ombre joue le jeu de la vérité, car celle-ci meurt à la lumière. Le scialytique, cet appareil d’éclairage nommé « dissipateur des ombres », convient à la seule inspection chirurgicale ou archéologique. Il ne peut pas éclairer ni un plateau de scène, ni une promenade publique, ni une salle de réunion. La vérité anatomique ou géologique est exactement la vérité qui dissout dans son opération la vérité toujours plus intime, toujours plus enfouie, fuyante et indécise, qui est la vérité de toute autre vérité, le jeu d’une pensée obombrée.
La pensée obombrée, la pensée ombragée – pensée à l’ombre des bosquets, promeneuse sous la charmille, penchée sur l’ombre de la main que projette la chandelle – la pensée ombreuse qui s’égare dans les sous-bois, qui se glisse dans le dos des objets clairs, qui met ses pas dans ceux des mourants, des Doppelgänger et des ectoplasmes, la pensée qui recoud son ombre à chaque Peter Pan venu de Nulle Part, c’est elle, la pensée, la seule pensée vivante.
Car le soleil tue et celui qui brille au sommet dont la caverne aux ombres est surplombée, ce soleil-là tue plus impitoyablement et plus impeccable-ment qu’aucun autre. Sa vérité n’est rien que l’explosion atomique, la brûlure de mille milliards de soleils, cela même dont la vieille humanité se menace de s’éblouir dans un tout dernier spasme.
Le soleil tue cependant que la pensée qui s’en détourne est celle qui sait trouver la vérité dans le jeu de l’ombre. C’est la vérité violette ou ardoise des frondaisons d’été : celle que les peintres recueillent au bout des pinceaux. C’est la vérité grenue, poudreuse et grisonnante des photographies. C’est la vérité de tout ce qui n’est que l’ombre de soi-même : cela qui ne revient plus à soi, qui ne cherche plus à s’identifier en tant que spectateur émerveillé de l’éclat de l’être. Cela qui reste, impalpable presque, accroché au rebord de la lumière et comme le souvenir indistinct de son insolente splendeur.
Nous sommes, nous-mêmes, tout autant que nous sommes, les ombres dont cette vérité compose son imperceptible évanouissement. Nous glissons entre soleil et nuit, nous n’habitons ni l’un ni l’autre, nous ne discernons pas nos propres pas. Mais nos yeux se laissent toucher par l’ombre, et cela même donne un relief au monde : non pas l’exposition brutale à la clarté, mais le vallonnement, la houle sur la mer, le chatoie-ment du ciel à travers les branches, le clair-obscur tellement plus vrai que l’azur.